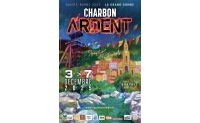Cabaretiers et aubergistes à Alès
De tout temps, et sous des noms divers, il y a eu des cabaretiers ; mais ce n'est qu'à une date peu ancienne qu'en France les cabaretiers ont formé un corps de métier, une corporation. Jusque vers la fin du seizième siècle, on n'avait pas considéré cette profession comme un métier proprement dit, c'est-à-dire entraînant un apprentissage accompli dans certaines conditions, une maîtrise obtenue après certaines épreuves. Pouvait se faire cabaretier qui voulait, en payant certains droits et en se conformant aux ordonnances de police. C'est ce qui est exprimé clairement dans le Livre des métiers d’Étienne Boileau. Ce texte nous prouve même que les taverniers (on ne distinguait pas alors entre ceux-ci et les cabaretiers) pouvaient vendre leur vin au taux qui leur convenait, pourvu qu'ils se servissent des mesures légales ; c'est une liberté qu'ils perdirent dès le quatorzième siècle.
Plusieurs ordonnances réglèrent alors le prix du vin. En 1351 notamment, Jean II fixa le prix du vin rouge français à 10 deniers la pinte, et le blanc à 6 deniers parisis. De même, en 1590, pendant la Ligue, le vin fut vendu, par ordre, le vieux à 6 sous, et le nouveau à 4 sous la pinte. Toutefois, c'étaient là des mesures qu'on ne prenait guère qu'aux temps de calamité publique. Les statuts des cabaretiers, et par conséquent leur réunion en corps de métier, ne remontent pas au delà de 1587. Henri III donna des règlements communs aux marchands de vin, aux taverniers, aux cabaretiers, et aux hôteliers. Les taverniers ne pouvaient vendre que du vin « au pot », c'est-à-dire à emporter, comme les marchands de vin. Les cabaretiers, non seulement vendaient le vin au détail, mais donnaient à manger, et, par suite, payaient des droits élevés. Plus tard, ces différences disparurent en partie. Ainsi, une déclaration royale de 1680 permit aux taverniers de vendre des viandes qui avaient été cuites à l'avance par les maîtres rôtisseurs ou les charcutiers : ce privilège s'étendit aux marchands de vin. Enfin, en 1698, on permit aux taverniers de faire rôtir des viandes, sans toutefois leur permettre d'avoir des cuisiniers à gages. Les charcutiers obtinrent du moins qu'il leur fût interdit d'élever et de tuer aucun porc, ce qui fit que les taverniers durent rester malgré eux les pratiques des charcutiers, et les meilleures sans doute. Il est à peine utile d'ajouter que cette disposition prohibitive s'appliquait également aux cabaretiers, dont toutes ces ordonnances ne faisaient certainement pas les affaires.
Les statuts de 1587 se composaient de trente articles. En 1647, ils furent confirmés et développés en quarante articles. L'élection des quatre gardes du métier, renouvelés tous les ans deux par deux, offre une singularité que l'on retrouve dans quelques au-tres corporations, celle des drapiers, par exemple. Le nombre des maîtres étant fort considérable, soixante d'entre eux seulement prenaient part aux élections ; l'année suivante, c'était le tour de soixante nouveaux, et ainsi de suite, sans qu'on pût être électeur pendant deux années consécutives.
L'apprentissage durait quatre ans ; mais deux ans de service étaient nécessaires pour obtenir le titre de maître. Pour être cabaretier, il fallait être catholique romain. Cette disposition se trouve déjà en 1587 ; en 1647, elle fut maintenue. Les cabaretiers ne devaient recevoir personne chez eux le dimanche pendant les offices, et de même pendant les trois derniers jours de la semaine sainte. Les officiers de police visitaient les boutiques pour s'assurer de l'exécution de ces règlements. En cas de contravention, les cabaretiers étaient passibles de fortes amendes, et même parfois, s'il y avait récidive, de peines corporelles. Pendant le carême et les jours maigres, aucune viande ne devait être fournie par les cabaretiers à leurs pratiques. Un arrêtés de police réglant la matière, considéraient les cabarets comme des lieux publics exclusivement ouverts pour la commodité des étrangers et d'où les habitants du lieu même devaient être exclus ; cette défense s'étendait surtout aux gens mariés ayant ménage et aux domestiques ; mais cette prohibition excessive était à peu près sans effet.
Il en fut presque de même de l'interdiction des jeux de hasard. Les cabarets devaient être fermés de bonne heure ; les heures variaient seulement selon les ville et les saisons. A Paris, c'était entre six et sept heures de la Saint-Rémi (c'est-à-dire du 1er octobre) à Pâques, et entre huit et neuf heures de Pâques à la Saint-Rémi. Tels étaient au moins les termes des ordonnances ; mais un avis placardé par le lieutenant de police, tous les ans, au commencement de l'hiver, fixait souvent des limites moins étroites, et même on peut croire que bien des cabarets restaient ouverts une partie de la nuit.
Il fallait une enseigne. La plupart du temps c'était simplement un buisson ou, pour mieux dire, « un bouchon » ; d'où le nom de « bouchon », qui est resté en usage pour signifier un cabaret de chétive apparence. En 1695, on ordonna aux cabaretiers « de garnir leurs caves de toutes sortes de vin et d'en débiter au public à divers prix, bon vin et droit, loyal et marchand, sans être mélangé, n'excédant le prix qui sera par nous mis d'année en année ; tous les cabaretiers seront tenus mettre une pancarte où ledit prix sera écrit, à peine de 400 livres parisis d'amende ».
Mais que peuvent les lois contre les falsifications ? Les cabaretiers continuèrent à composer une boisson étrange, où il n'entrait pas une goutte de jus de la treille ; on le remplaçait par du bois de teinture et de la litharge, et cela malgré toutes les épigrammes, malgré toutes les chansons, bonnes ou mauvaises, comme ce couplet d'un buveur mécontent, d'aussi pau-vre qualité que le vin qui l'inspira :
Tremblez, tremblez, empoisonneurs !
De tous vos malheurs
On ne dira pour vous nul Libera,
On maudira le père qui vous engendra ;
Au lieu d'un bon Salve,
Vous entendrez crier Tolle.
Un poète moins maussade disait :
Quoique en tout lieu on frelate
Les vins de toutes façons,
Comme un autre Mithridate,
Mon corps s'est fait aux poisons.
Les cabaretiers, d'une honnêteté relative, ne voulant point empoisonner leurs pratiques, de crainte de les perdre sans doute, se contentaient de baptiser fortement leur vin. Un enfant naïf trahit un jour le secret d'un des cabaretiers les plus en vogue. Quelqu'un étant allé lui demander une bouteille de vin à 8 sous, ne trouva au comptoir qu'une fillette de neuf à dix ans. « Nous n'en avons plus à ce prix, dit-elle ; mais attendez un moment, papa va rentrer. Il vous en fera tout de suite ; il y a un puits dans la cave ».
En Cévennes le transport par mulets et par roulage nécessitaient des affenages et des auberges où l'on logeait à pied et à cheval. A Alès, ces auberges étaient plus nombreuses à proximité des portes où aboutissaient les principales routes.
En 1610, nous trouvons, près de la porte de la Roque, par où on venait de l'Auvergne, dans la Grand'Rue, l'auberge de la Pomme, et celle de l’Écu-de-France, qui dut, en 1794, changer son nom contre celui de Aux-bons-sans-culottes. Au départ de la route de Bagnols, non loin de la porte Saint-Vincent, était le Lion-d'Or, où, en 1608, les notables alésiens ayant tiré bon pommeau, les pomelaires banquetèrent ; cette auberge n'a disparu qu'en 1885, lors de la construction du lycée.
A l'arrivée de la route de Nîmes, à côté de la porte Saint-Gilles, était le logis du Luxembourg, « Emplacement du cinéma Les Arcades ») celui du Midi, et l'auberge de la Couronne (Emplacement du café de la Couronne, avenue Carnot). De l'autre côté du pont Vieux, où aboutissait la route d'Anduze et de Montpellier, soit l'ancienne, soit la nouvelle établie à la fin du 18e siècle, ainsi que la route venant de Mende, une enseigne représentant un grand soleil désignait l'auberge portant ce nom. Elle existait encore dans les premières années du siècle dernier. Lors de l'ouverture de la deuxième gare du chemin de fer, à l'angle du boulevard Louis-Blanc et de celui de la Gare, l'hôtel du Commerce s'ouvrit au n° 2 de l'actuel boulevard Louis-Blanc. Vers la fin du Second Empire, il reçut plusieurs hôtes illustres, Victor Duruy, Jean-Baptiste Dumas et Pasteur. Après qu'une quatrième gare eut été établie là où elle se trouve maintenant, l'hôtel du Commerce, trop éloigné, vit son activité diminuer, et finit par se fermer.