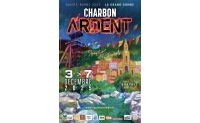Le camp d’internement de Saint-Nicolas dans le Gard en 1940 PAR JEAN-CLAUDE VIMONT · 9 NOVEMBRE 2014
Recueil de publications.
A proximité de Nîmes, les autorités françaises improvisèrent un camp de toiles durant l’été 1940 afin d’accueillir des civils allemands et autrichiens, précédemment internés dans le Camp des Milles. Ils avaient obtenu de l’officier commandant ce camp d’être éloignés d’une région qu’ils pensaient susceptible d’être envahie par les troupes allemandes. Fin juin 1940, un train achemina environ 2000 anti-nazis vers la côte atlantique jusqu’à Bayonne, ville qui fut bientôt intégrée à la zone occupée, puis il revint en arrière jusqu’à Nîmes. Il n’est pas aisé de localiser ce camp puisqu’il est nommé parfois camp de tentes de Saint-Nicolas, camp des Garrigues-Saint-Nicolas ou encore camp de Saint-Nicolas-des-Garrigues. Si on suit le témoignage de l’écrivain Lion Feuchtwanger, auteur du Juif Süss et porte-parole des internés des Milles, les autorités militaires auraient créé un camp aux alentours de la ferme Saint-Nicolas dans les derniers jours de juin 1940 et les tous premiers de juillet 1940. Il s’agit probablement du mas Saint-Nicolas , un ancien relais de diligences de l’Ancien Régime, acquis en 1950 par les autorités militaires et intégré dorénavant au camp de manoeuvre des Garrigues. Le camp était donc situé sur la commune de Sainte-Anastasie, à proximité du pont de Saint-Nicolas de Campagnac qui surplombe le Gardon, au nord de Nîmes. La commune disposait de plus de 4000 hectares de garrigues. Le camp militaire qui existait déjà à l’époque et comportait plusieurs bâtiments en dur avait été fondé en 1877 et se trouvait à proximité du camp de tentes. Le train des internés, de retour de Bayonne, s’était arrêté le 26 juin 1940 sur une voie annexe, au milieu d’un pré, au nord de Nîmes. Commença alors une marche d’une quinzaine de kilomètres mêlant soldats, officiers, internés autrichiens, internés allemands et anciens légionnaires de ces nationalités. Le peintre Hermann-Henry Gowa conçut une toile où la marche du 27 juin 1940 des internés vers la ferme de Saint-Nicolas est figurée. Des soldats coloniaux arabes les escortaient. Ils arrivèrent « devant un vieux portail monumental sur lequel, en lettres ornementées, on pouvait lire la mention: « Saint-Nicolas ». Ce portail donnait accès à la cour d’une ferme qui semblait ouverte depuis longtemps » (Lion Feuchtwanger, Le diable en France, (première publication en 1942 aux Etats-Unis, Le livre de poche, 2012, p.227). L’administration militaire du camp s’était installée dans les communs de la ferme. Le commandant y recevait les prisonniers porteurs de doléances dans la salle à manger ornée de fresques défraîchies de fruits et de gibier. Des soldats, derrière leurs machines à écrire, composaient des listes, rédigeaient des laisser-passer, s’occupaient de l’intendance. La porcherie devait servir de prison pour les évadés qui étaient ramenés par les brigades de gendarmerie. Un grand pré planté de muriers fut assez vite entouré de fils barbelés. Des tentes blanches de l’armée coloniale, rondes en forme de chapiteaux, appelées marabouts furent installées peu après. Lion Feuchtwanger écrivait : « Ces chapiteaux blancs très pimpants plantés sur le vert des prés au milieu de ce paysage charmant nous donnaient une impression d’harmonie, de beauté et de sérénité. » Quelques bottes de pailles furent livrées dans chaque tente, mais elles ne préservaient guère, la nuit, de l’humidité du sol. Il y faisait froid la nuit et la chaleur y était étouffante à midi. Les tentes accueillaient seize hommes. Des sentinelles gardaient l’entrée du camp mais elles toléraient que les internés passent sous les barbelés pour sortir du camp. Plus de 2000 internés séjournèrent dans ce centre de regroupement d’étrangers. Des internés allaient jusqu’à Nîmes, se mêlaient aux flux de réfugiés, déjeunaient dans des restaurants, s’approvisionnaient, s’offraient une nuit et un bain dans un hôtel. Mais ils n’étaient qu’une minorité à bénéficier de ces privilèges. Les internés vivaient misérablement, vêtus de loques. Dans le camp, de menus trafics furent organisés. Des Viennois installèrent des tables où ils vendaient café et pâtisseries. Il y eut même de petits restaurants où les officiers de la garde n’hésitaient pas à se restaurer. Dans l’allée centrale du camp, des échoppes offraient des montres, des vêtements, de la nourriture : une véritable foire, bruyante et colorée. Des habitants des environs venaient proposer du lait, du pain, car l’ordinaire était médiocre, à des prix supérieurs aux cours en vigueur dans la ville proche. Des camelots vantaient leurs marchandises dans les ruelles entre les tentes : des stylos, des journaux parisiens, des faux passeports. Mais le quotidien des internés, c’était aussi les moustiques, l’odeur épouvantable des latrines et des déjections qui encerclaient le camp au-delà des barbelés. Les internés allaient et venaient le visage masqué de gaze rouge ou verte pour se préserver des insectes. Le soir, ils allumaient des feux devant les tentes, agitaient des branchages pour que la fumée écarte les moustiques. Plus de cent prisonniers se présentaient chaque jour à la visite médicale : dysenteries fréquentes, quelques cas de typhus. Les témoignages évoquent une certaine anarchie au sein du camp, l’absence de véritable représentation des internés, la crasse, la négligence, l’indolence et la mollesse des autorités. Après quelques semaines, femmes et enfants furent autorisés à pénétrer dans le camp. Certaines y demeuraient la nuit. Les internés appréciaient ce séjour après les dures conditions d’hébergement au camp des Milles dans la tuilerie poussiéreuse. Mais dès qu’ils eurent connaissance des termes de l’armistice, l’inquiétude parcourut leurs rangs. La clause 19 précisait que les autorités françaises devaient livrer aux Occupants les ressortissants du Reich qu’ils réclamaient. Environ 300 internés pouvaient craindre pour leur vie. Les autorités françaises allaient-elles livrer des listes aux allemands de la commission Kundt qui parcouraient les camps d’internement ? Fallait-il rester dans le camp avec le risque d’être transféré dans un camp de concentration allemand ? S’évader, c’était un plongeon dans l’inconnu, sans les papiers nécessaires pour affronter les contrôles des gendarmes, sans les tickets de rationnement indispensables pour se nourrir, sans les passeports pour réclamer un visa et quitter la France. Lion Feuchtwanger a parfaitement résumé l’état d’esprit des internés : « Ce souci, cette question funeste, ne cessait de nous tarauder : les Français allaient-ils nous livrer aux nazis ? Elle nous tenaillait, cette inquiétude, quand nous mangions et buvions, elle planait au-dessus de nos têtes quand nous discutions et elle nous rongeait quand nous dormions. Nous faisions semblant de prendre au sérieux les petits problèmes qui faisaient notre quotidien – la nourriture, l’eau, l’ambiance de foire qui régnait dans le camp, les hôtels de la ville de Nîmes, ses restaurants et ses filles. Mais quand nous songions à nous-mêmes et à notre situation, nous le faisions avec circonspection ; nous avions constamment conscience de la vanité de ces choses en comparaison du danger qui planait au dessus de nos têtes » (Le diable en France, p. 247). Plusieurs artistes vécurent sous les tentes du camp Saint-Nicolas. Max Ernst, qui évoqua ainsi le camp improvisé de Saint-Nicolas « Notre prochaine prison dans les garrigues du Gardon, infestées par les moustiques et la garde mobile sera une prison mixte ». Il s’en évada, fut repris puis profita de la filière américaine qui protégea nombre de surréalistes et d’artistes. Il y eut aussi Franz HesselWols (Alfred Otto Wofgang Schulz) qui fut libéré en octobre 1940. Il y avait aussi Hermann-Henry Gowa qui avait séjourné au camp de Lambesc, puis au camp des Milles et qui devait ultérieurement rejoindre la résistance. Le Mémorial du camp des Milles évoque ce séjour à proximité de Nîmes. Il ne semble pas que sur place, dans le camp militaire des Garrigues, dans la commune d’Anastasie, plaques, stèles ou indications mentionnent ce camp provisoire pourtant si symbolique de ces moments d’incertitude que vécurent des centaines d’étrangers qui avaient cru avoir trouvé refuge en France. Dans le désordre de l’été 1940, ils subirent l’indolence, le je-m’en-foutisme d’une administration incompétente et xénophobe. Les recherches d’Anne Grynberg signalent pourtant qu’un interné du camp de toiles fut livré aux autorités nazies.
Comme on le sait, une stèle est la statue d’un lieu. Elle le constitue en point de repère de la mémoire historique, comme une épingle sur une carte d’état major.
Un lieu en manque, et l’on ne devrait pas tarder à l’en pourvoir : le camp d’internement de Saint Nicolas de Campagnac, situé dans les limites administratives de la commune de Sainte Anastasie du Gard et de celles de Nîmes, à l’intérieur du terrain militaire des garrigues (actuellement géré par le 2e Régiment étranger d’infanterie), à proximité du croisement des routes qui relient Nîmes, Uzès et Poulx (départementales 979 et 135).
Dans ce camp, ouvert depuis janvier 1940 pour environ 200 « étrangers hostiles » (surtout allemands et autrichiens), et qui hébergeait déjà autant de républicains espagnols (1), arrivèrent, le 27 juin 1940, après cinq jours d’un tragi-comique périple en train et d’une marche à pieds de quinze kilomètres, environ 2000 détenus provenant du camp des Milles. (2)
Les conditions de vie y étaient rudes. Les internés, logés dans une centaine de tentes « marabout » pourvues d’un sol en paille, souffraient du mistral, de la chaleur, des insectes, de la dysenterie et de l’angoisse d’être livrés aux nazis (la commission Kundt, chargée du recensement et de la sélection des internés de guerre, fut active peu après la signature de l’armistice et se présenta effectivement début août).
Le commandement du site siégeait dans les bâtiments du Mas Saint Nicolas, qui était peut-être un ancien relais de poste, et dont aujourd’hui ne subsistent que quelques murs en ruine. Le camp fut vraisemblablement fermé à l’automne 1940. Certains s’enfuirent (l’écrivain Lion Feuchtwanger, le peintre Max Ernst) ; d’autres en furent libérés (Franz et Ulrich Hessel, le père et le frère de Stéphane) ; au moins un fut reconduit en Allemagne (3) (naturellement, la plupart de ces prisonniers étaient des Krieghetzer, soit des opposants et/ou des juifs).
Deux tableaux du peintre Henry Gowa, lui aussi interné, La marche de Saint Nicolas et Les naufragés, témoignent de cette expérience. Lion Feuchtwanger et Max Ernst la décrivent dans deux livres. Le galeriste Alain Paire et l’historien André Fontaine ont publié des travaux de recherche. Des informations fragmentaires se trouvent dans les biographies des personnes ayant séjourné dans ce camp de la garrigue (4), ainsi que dans les sites web consacrés à la déportation.
Mon propos est de parler de ce lieu, pour qu’on en connaisse mieux l’histoire, et pour que – éventuellement – un signe de mémoire y soit apposé.
(1) « CAMP DES GARRIGUES II est situé dans le vaste terrain de manoeuvres militaires du même nom à 10 km au nord de Nîmes et jusqu’au bord du Gardon. Ouvert en janvier 1940 pour 200 détenus millois, il est contigu à un autre camp réservé aux deux cents réfugiés espagnols qui ont eux mêmes monté leurs baraquements en parpaings après avoir souffert du fort mistral tout le temps qu’ils ont vécu sous la tente. Ils cèdent une maisonnette aux Allemands qui, en attendant, en sont réduits à s’entasser et à en construire une deuxième le plus rapidement possible. » André Fontaine, « Quelques camps du sud-ouest (1939-1940) », Recherches régionales n.104, 1988.
(2) Le 22 juin 1940, une semaine après l’entrée de l’armée allemande à Paris et le jour même de la signature de l’armistice, les internés antinazis du camp de Milles obtinrent d’être déplacés en train à Bayonne, dans l’espoir d’y trouver un navire pour s’échapper. Ils en furent refoulés, sur un malentendu quant au mot « allemand » et probablement on trouva en toute hâte la solution provisoire du camp des garrigues.
(3) Anne Grynberg, « Les camps du sud de la France : de l’internement à la déportation », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, N. 3, 1993, p. 562. (4) Avec certitude : Max Ernst, Franz Hessel, Ulrich Hessel, Lion Feuchtwanger, Wols (le peintre et photographe Alfred Otto Wolfgang Schulz), Henry Gowa.
Marie-Paule Hervieu sur Feuchtwanger
(http://www.cercleshoah.org/spip.php?article239)
Lion Feuchtwanger, après avoir habité Sanary, lieu de rencontre d’intellectuels allemands antifascistes en exil, est interné au camp des Milles en 1939 et 1940. “Le train-fantôme” évacuant les détenus devant l’avance allemande, suscite la rumeur que “2000 boches” allaient arriver à Bayonne, ce qui provoque leur retour et leur internement au camp de Saint-Nicolas, près de Nîmes, d’ou Feuchtwanger s’évade déguisé en femme. Il vit caché chez le vice-consul américain à Marseille, en attendant que Varian Fry le fasse passer en Espagne avec sa femme Marta… (…) Un écrivain remarquable. Né à Munich le 7 juillet 1884, Lion Feuchtwanger était d’une famille juive allemande religieuse, dont il garde la mémoire avec quelques citations bibliques en référence « aux enfants d’Israël contraints de fabriquer des briques destinées aux entrepôts de Pitom et de Ramsès ». Mais le jeune homme, brillant intellectuel, choisit de faire une carrière littéraire, avec entre autres la publication, en 1925, du Juif Süss – chef-d’oeuvre du roman historique allemand, selon Thomas Mann –, qui lui valut une célébrité mondiale et fut traduit en quinze langues. OEuvre que les nazis tentèrent de s’approprier, en la dénaturant complètement, avec le film de Veit Harlan. Et pourtant l’auteur n’est pas, par eux, récupérable, pacifiste en 1914, antifasciste de la première heure, en tournée de conférences aux États-Unis en 1932-1933, il choisit de ne pas rentrer en Allemagne, à Berlin, alors que les SA mettent à sac sa maison de Grunewald, près de Berlin, et que le gouvernement d’Hitler lui retire sa nationalité allemande, le 23 août 1933. (…) Un train pour Bayonne (juin 1940). Mais le pire est à venir avec l’arrivée au pouvoir de Philippe Pétain et de Pierre Laval, et la signature, le 22 juin 1940, de l’armistice dont l’article 19 fait obligation au gouvernement français de livrer sur demande les ressortissants allemands désignés par le gouvernement du Reich, c’est-à-dire les réfugiés politiques et, à terme, avec la loi du 4 octobre 1940 sur les « ressortissants étrangers de race juive », les Juifs internés ou raflés. A l’internement, s’est donc s’ajouté le risque de mise à mort, immédiate ou différée, par remise à leurs bourreaux, des Allemands et des Autrichiens, pour des raisons politiques, voire « raciales ». Et là, l’analyse se fait plus politique, Lion Feuchtwanger parle de « vieux général » et de « cabinet fasciste » (page 181). De même, page 184, il écrit : « Les fascistes français avaient livré leur pays à l’ennemi. Le coup était rude pour nous, mais cela ne signifiait nullement que la guerre était perdue… Au fond ce n’était qu’une confirmation de ce que nous savions d’entrée : les fascistes de tous les pays, le cas échéant, sacrifient sans scrupules l’intérêt national à leurs intérêts particuliers » et page 205 : « Nous les Allemands de gauche étions pour les dirigeants fascistes de la France des ennemis bien plus haïssables que les nazis et il ne faisait aucun doute qu’ils nous extraderaient », d’ou la pression exercée sur les autorités militaires, par des prisonniers sans papiers, qui se savaient menacés dans leur vie, pour que soit organisé un train d’évacuation permettant d’échapper à l’armée et à la police allemandes. Ce fut ce que Lion Feuchtwanger a appelé un « train de la mort [6] », parti le 22 juin, avec quatre cents détenus transportables, dans des wagons de voyageurs et de marchandises, gardés par des soldats algériens. Le convoi passa par Arles, Sète, Tarbes, Lourdes, Pau, Oloron pour arriver à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, où il apparut très vite que toute émigration par voie maritime ou évasion par voie de terre était condamnée à l’échec pour des Allemands sans papiers et a priori suspects. D’ou le retour, par Toulouse, vers Nîmes, dans de très mauvaises conditions : « Il pleuvait toujours, et le froid humide nous transperçait. Nous étions épuisés par la tension nerveuse et les émotions de la journée. Nous étions tenaillés par la peur d’être attaqués l’instant d’après par les nazis. Chacun haïssait l’autre, chacun se querellait avec son voisin » ; et, toujours page 179, «Les malades gémissaient et les bien-portants se plaignaient ; d’autres ronflaient, et le wagon tout entier, plongé dans le noir et envahi par des odeurs nauséabondes, suintait l’angoisse. Nous étions debout, nous nous balancions au rythme du train. Certains sanglotaient… » Le troisième internement, dans le camp de tentes de la ferme Saint Nicolas, près de Nîmes, en zone non occupée. A quinze kilomètres, dans la montagne, les conditions de vie des deux mille internés sont moins rudes : si le camp est « ouvert », dans la mesure ou les barbelés et les soldats de garde n’interdisent pas les descentes à la ville, de même que les visites de membres de la famille – Lion Feuchtwanger y a reçu la visite de sa femme évadée de Gurs pendant quatre jours –, le camp n’en reste pas moins surveillé et les évadés sont recherchés et ramenés par la gendarmerie française. Les corvées sont multiples, les latrines inexistantes, les moustiques abondent et la dysenterie menace, Lion Feuchtwanger en a été atteint et est resté quelques jours en péril de mort. Et surtout « le désespoir se faisait de plus en plus fort au milieu de cette ambiance de foire », avec des trafics en tous genres. Ce qui nous rongeait, ce n’était pas seulement le danger, on ne peut plus tangible, de la clause d’extradition, c’était aussi cette inactivité forcée, l’absurdité apparente de notre séjour dans le camp. On tournait en rond, on bavardait, on parlait toujours des mêmes choses, et l’on attendait de tomber malade ou d’être livré aux nazis » (page 256). L’obsession de ces hommes était donc d’être libérés ou, à défaut, de récupérer leurs papiers et de gagner Marseille. L’évasion et le sauvetage. C’est dans ces conditions qu’avec l’aide de sa femme et du consulat américain de Marseille, Lion Feuchtwanger s’évade, habillé en dame anglaise. Revenus et cachés à Marseille, Lion et Marta Feuchtwanger empruntent la voie de terre, en traversant à pied les Pyrénées, puis ils gagnent Barcelone et prennent le train pour Lisbonne. Lion s’embarque pour les États-Unis sur l’Excalibur et débarque à New York le 5 octobre 1940, Marta le rejoint 15 jours plus tard, ils sont sauvés.