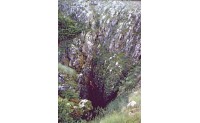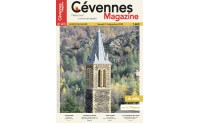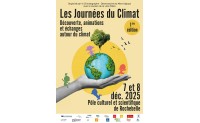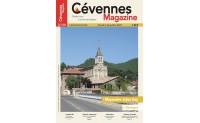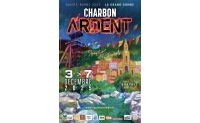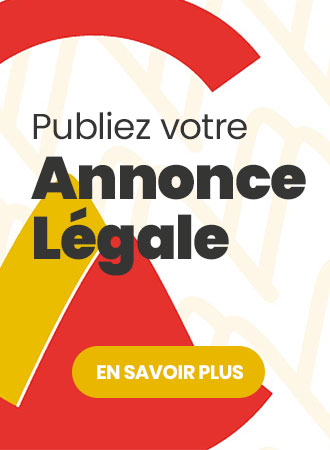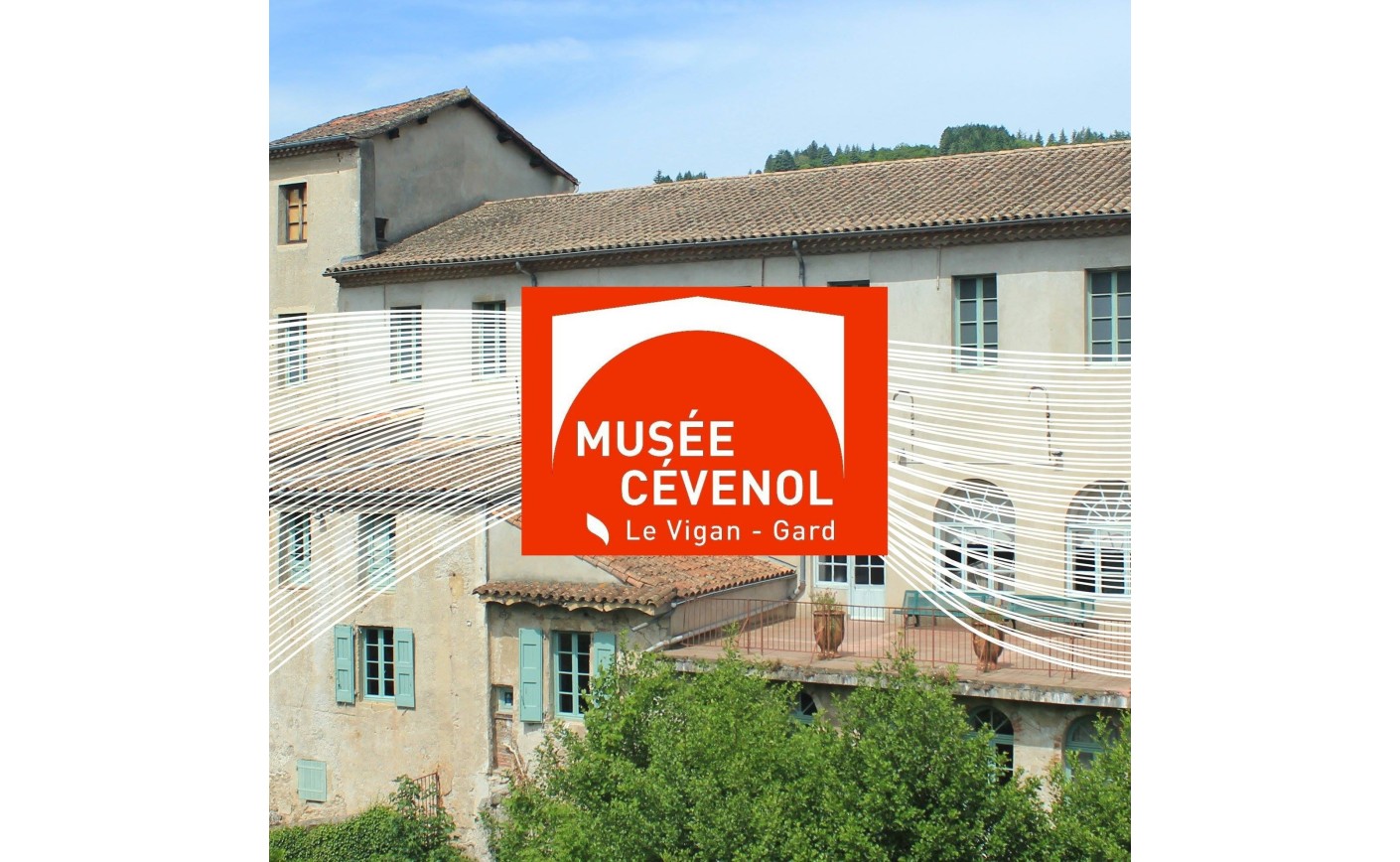
Les Causses et les Cévennes, avec leur biodiversité remarquable, ont longtemps été le creuset de pratiques botaniques riches et variées. Ici, les plantes ne sont pas de simples éléments de la flore, mais participent d’un patrimoine culturel et thérapeutique pour les hommes et leurs animaux.
L’exposition temporaire au Musée cévenol « Les plantes qui soignent, histoire de la botanique et de la médecine dans les Causses et les Cévennes méridionaux » explore la manière dont les habitants des Causses et Cévennes ont su tirer parti des ressources végétales locales pour développer des savoirs médicinaux. Réalisée avec le soutien du Leader Gal Aigoual, Cévennes, Pic Saint Loup et cofinancé par l’Union européenne retrace l’évolution de ces pratiques, de la tradition orale à la médecine moderne. Elle met aussi en lumière le rôle des médecins botanistes formés à Montpellier, partis dès le XVIe siècle à la recherche de plantes curatives dans les montagnes cévenoles.
Pour les journées européennes du patrimoine le samedi 20 septembre 2025 à partir de 16h, le Musée cévenol accueille deux conférences :
« Savoirs sur le corps et la maladie » par Jacques Frayssenge Historien
Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir dans des archives anciennes, un parcours varié que retracent minutieusement les correspondants de la Société Royale de Médecine. Le Rouergue et le Languedoc ont fait l'objet de mémoires précis, de séries détaillées d'observations cliniques.
« Le panicaut : du chardon à cent têtes à l’herbe de la Gorgone » par Annick Fédensieu, Ethno-botaniste.
L’occasion d'explorer le passionnant panicaut épineux, plante qui a traversé les âges, conservant des usages variés et surprenants qui vont de l'Antiquité à nos jours.
L'entrée est gratuite et aucune réservation n'est nécessaire.
À 16h Jacques Frayssenge
« Savoirs sur le corps et la maladie »
D'après la correspondance des médecins rouergats et languedociens à la Société Royale de Médecine. (Fin du XVIIIe siècle).
Les archives anciennes de la Société Royale de Médecine offre un riche territoire au chercheur soucieux d'étudier dans une perspective anthropologique, les représentations du corps, de la santé et des maladies. Histoire des états de santé, déchiffrement de maladies manquées sous un vocabulaire approximatif, origine, impact et développement des épidémies, modes de vie et d'hygiène dans les campagnes ou dans les villes : c'est un parcours varié que retracent minutieusement les correspondants de la Société Royale. Le Rouergue et le Languedoc ont fait l'objet de mémoires précis, de séries détaillées d'observations cliniques. Le dépouillement de quelques études rédigées par des médecins de Millau, Saint-Affrique, Mende, Nîmes et Béziers fait ressortir les trois ou quatre maladies les plus couramment soignées dans ces provinces (variole, dysenterie, fièvre…), les symptômes qu'elles revêtaient, la gravité de leurs effets, les soins administrés... L'observation de ces maux s'accompagne d'hypothèses théoriques dont la plus déterminante est bien celle qui fait de l'évolution du climat et des saisons, l'un des facteurs décisifs de la santé des populations. Ainsi, dans les archives de la Société Royale de Médecine transparaît une véritable archéologie du regard médical en rupture avec les pratiques empiriques des "femmes", des "prêtres" et des "charlatans"…
A 17h Le panicaut : du chardon à cent têtes à l’herbe de la Gorgone » par Annick Fédensieu, ethnologue.
Du panicaut, vagabond épineux champêtre ou maritime (Eryngium sp.), « on rapporte des choses prodigieuses » confie Pline au premier siècle de notre ère. Les anciens herbaires décrivent les propriétés bénéfiques de cette plante alimentaire et médicinale, diurétique et emménagogue, qui guérit également les morsures de bêtes venimeuses, soigne le haut mal et défait les ruses des démons. Les recettes épicées médiévales soulignent les vertus aphrodisiaques de sa racine confite, tandis qu’à la Renaissance les Anglais vantent sa réputation « régénérante » et la préconisent dans la cure de la mélancolie.
Aux Pays-Bas et en Allemagne, elle devient une fidèle compagne de l’homme, charme amoureux ou amulette protectrice dans les moments d’infortune. Il s’agira ainsi de suivre les destinées de cette « herbe de la Gorgone », racine sexuée au dire de Pline, qui suscita la passion funeste de Sappho, l'étonnement de Plutarque et des philosophes byzantins, mais encore l’inspiration de Dürer.