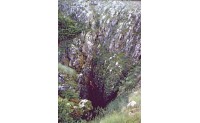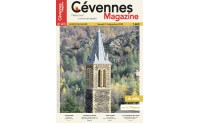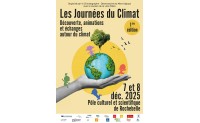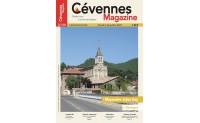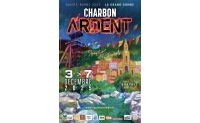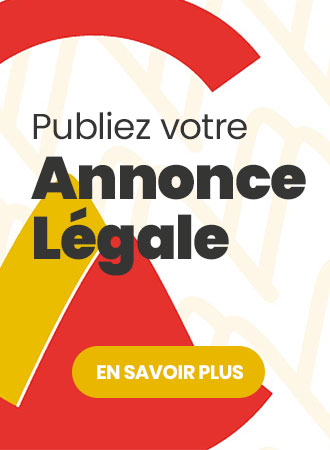LA VIGNE NE PISSE PLUS !
La viticulture française, et en particulier celle du Languedoc, a une histoire pour le moins compliquée avec une crise majeure - celle du phylloxéra - en 1907 ; c’est à partir des années 1860, que cet insecte, porteur de la maladie de la vigne éponyme, s’en prend aux racines et provoque la mort des souches en quelques années. La production viticole française s’effondrera dans les années 1870.
Pour remédier à cette situation, on importera et greffera sur eux-mêmes des cépages américains, dont un que les Cévenols connaissent bien : le Clinton.
Là, avec un autre cépage, l’Aramon, ont fait « pisser la vigne » ; expression pour désigner un vignoble où l'on cherche à obtenir le rendement maximal aux dépens de la qualité du vin.
À l’époque, les quatre départements du Languedoc produisent environ 40 % du vin français. Cette situation entraînera des productions abondantes en 1904, 1905 et 1906, qui feront chuter les cours. Cette surproduction hexagonale, augmentée par l’arrivée des productions de nos colonies et celles de pays voisins, amènera à la révolte des vignerons dite aussi celle de Marcelin Albert, en 1907. L’apogée est atteint le 9 juin 1907, avec plus de 600 000 manifestants à Montpellier. Plus grande manifestation de la troisième République, près d’un habitant du Languedoc sur deux s’y rend ; les soldats tirent sur la foule, faisant deux morts dont un adolescent.
Des négociations entre les syndicats viticoles et les gouvernements successifs aboutiront à l’interdiction de certains cépages fin 1934, dont le Clinton, l’Isabelle, le Noah, etc.
Ce début du XXe siècle verra aussi la création des caves coopératives, mais les crises ne s’arrêteront pas là et la récolte de 1950 est excédentaire, avec plus de soixante millions d'hectolitres. Le Languedoc est surnommé « Midi rouge » en raison de la tradition de révoltes qui s'y développent. En 1953, les viticulteurs barrent les routes et affrontent la police. Au début des années 1960, de nombreuses exploitations vigneronnes sont condamnées à fermer leurs portes. De 1955 à 1970, le nombre d'exploitations viticoles chute de 44 %. En 1971, les viticulteurs manifestent contre les importations de vins d'Algérie. De Charybde en Scylla, avec chaque fois les plus petits exploitants qui trinquent, on arrive à un nouveau drame le 4 mars 1976 à Montredon, où un vigneron et un CRS sont abattus au cours d'une manifestation des viticulteurs audois. Cette affaire sera classée par un de nos lecteurs, magistrat honoraire, par un bienvenu « non-lieu d’opportunité ».
Si l’Europe, la politique agricole commune, ne porte pas le coup de grâce, son action sera loin d’être bénéfique : les primes de 1979-1980, favorables à l'arrachage définitif, ont l'effet d'accélérateur d'une spirale suicidaire, titrait à l’époque notre confrère Midi Libre.
Et ça continue de nos jours !
La France produit près de cinq millions d’hectolitres en trop, dit le syndicat agricole majoritaire. La consommation de vin est en chute libre ; les Français n’en veulent plus, alors les prix baissent. Face à cela, la France a sollicité, et obtenu, de la Commission européenne, la possibilité d’allouer 120 millions d’euros à l’arrachage définitif de vignes. Les demandes d’arrachage portent sur 27 451 hectares dont 4 015 hectares dans le Gard. Le dispositif est assorti d’une aide de 4 000 €/ha.
La campagne d'arrachage mise en place par l'État pour faire face à la crise viticole, bat son plein. Elle a débuté le 1er janvier 2025 et court jusqu'à ce 21 juillet.
Ici et maintenant, en silence
Les campagnes d’arrachages, elles se passent sous nos yeux. Elles vont laisser un champ vide, une friche. De quoi modifier durablement les paysages et l’économie de nos zones rurales, sans que nos élus locaux s’expriment sur le sujet…
C’est Claude Masméjean qui arrache sous ma fenêtre, avec l’aide de Khalid. Claude, ça lui fait mal aux tripes. Pour lui, ce sont 5,30 ha qui sont arrachés, des vignes relativement jeunes qui auraient pu produire encore quelques belles années, essentiellement du Merlot et du Grenache.
Il faut le constater avec tristesse, cet arrachage s'apparente à un plan de liquidation des plus petites exploitations. Ce n’est pas un plan de restructuration cohérent, comprenant une vision stratégique sur le long terme, qui assurerait la pérennité des petites structures viticoles.
Ce lundi 21 juillet, il y aura plus de 4 000 ha de vignes en moins sur le Gard ; avec Claude, je suis triste, inquiet pour notre viticulture, et aussi révolté de l’inaction générale pour la sauvegarde de la viticulture locale.
Dominique Garrel
Crédit photos : Lisbeth Duquenne Holmberg