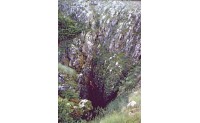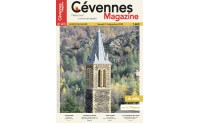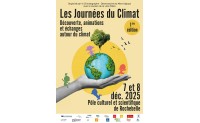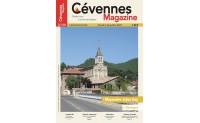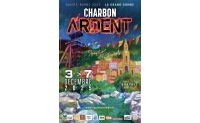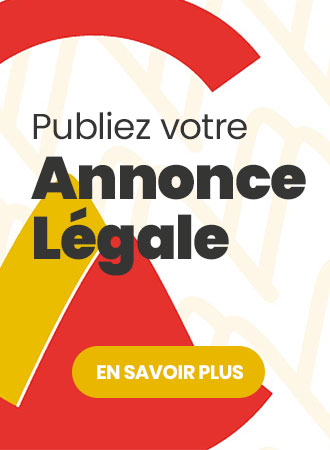SUR LA TERRE COMME AU CIEL… Notre relation au pain est-elle rompue ?
Par Dominique Garrel
Depuis les premières civilisations, le pain a toujours été bien plus qu’un simple aliment ; il était considéré comme une chose sacrée. Chez les Chrétiens et en particulier chez les catholiques, dans l’eucharistie - également appelée Saint-Sacrement, ou messe - l’officiant distribue l’hostie, le pain, symbolisant le corps du Christ, en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. ».
Dans la grande prière du « Notre Père », les Chrétiens récitent : « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Papa était directeur d’école catholique, et à la maison l’observation de rites religieux s’imposait naturellement ; c’est ainsi que chez nous, papa et maman, comme dans beaucoup de familles chrétiennes, marquaient du signe de la Croix le dos du pain avant de le couper. Bien évidemment, il ne fallait pas mettre la miche à l’envers, ce pain étant réservé au bourreau selon l’histoire moyenâgeuse.
Pour être syncrétique, je poursuis ici avec l’Islam, où le pain est vénéré. Le Coran mentionne les céréales comme un don de Dieu ; pendant le Ramadan, il joue un rôle clé lors des repas de l’iftar, où les familles et les communautés se réunissent pour rompre le jeûne quotidien. Dans le Judaïsme, le pain a une signification spirituelle à travers la célébration de la Pâque autour d’un pain (matsah) sans levain, appelé azym.
Jusqu’à un passé récent mais exception alésienne
Jadis, chaque maison possédait une pastière, meuble en bois qui servait à pétrir le pain. Si le pain était pétri dans la maison, il ne pouvait pas y être cuit ; il devait obligatoirement être apporté au four banal appartenant au seigneur du lieu. Cela lui procurait des revenus car chaque fois que l’on allait faire cuire son pain, on payait un droit de cuizande et un droit de fournage.
L'obligation imposée aux paysans d'aller cuire leur pain, contre le droit de banalité au four banal du seigneur, ne les encourageait pas à pétrir la farine. C’est pourquoi, par mesure d'économie, ils se contentaient d’une bouillie, pendant longtemps nourriture des ruraux.
L’accès au pain, aliment de base, a donné lieu à des tensions : en 1811, les miséreux de Sainte-Croix-Vallée-Française se ruent sur les moulins et volent blé et farine. Car bien souvent, on soupçonne le meunier de prendre plus qu'il n'a droit, et de conserver dans son grenier une partie des grains, abusivement détournée.
Notons cependant que la Charte d’Alès du XIIIe siècle dit : « Chacun est libre de moudre et de cuire où il veut. Il n’y a plus de four banal ni moulin obligatoire. » […]
Extrait d’un article du Cévennes Magazine n° 2366 du 15 novembre 2025 disponible chez votre marchand de journaux ou en commande sur notre site internet.